Franck Le Quellec




Lors du marché de créateurs·ices des Arts du Feu à Rennes, en décembre 2024, je rencontre Maëlle. Céramiste passionnée, elle me raconte avec ferveur la cuisson au four Anagama, une technique ancestrale où la flamme sculpte la matière. Ses mots vibrent d’enthousiasme et, bien que novice dans le domaine, je me laisse emporter par sa passion.
Janvier arrive, et avec lui la découverte du Périgord vert. Les collines ondulent sous un ciel d’hiver, la forêt s’étire en un enchevêtrement de branches dénudées, et l’air humide invite à se rassembler près du feu. C’est dans ce décor que se prépare un événement rare : après quatre ans de silence, un four Anagama s’apprête à reprendre vie.
Direction Abjat-sur-Bandiat, chez Tristan. Il y a dix-neuf ans, alors jeune céramiste, il entreprend la construction de ce four monumental sur le terrain hérité de son père. Pendant des années, trois à quatre cuissons y sont menées annuellement, jusqu’à ce que le temps et la chaleur mille fois attisée en exigent la rénovation.
Le démantèlement commence il y a trois ans, un travail lent, méticuleux. Puis, en octobre 2024, un cap est franchi : la préparation du four est programmée pour le 1er janvier 2025, afin de débuter la cuisson le neuf. Un symbole, un défi. Tristan et Maëlle, d’abord épaulé·e·s par quelques personnes, puis rejoints par une équipe grandissante, le chantier prend une ampleur vertigineuse.

















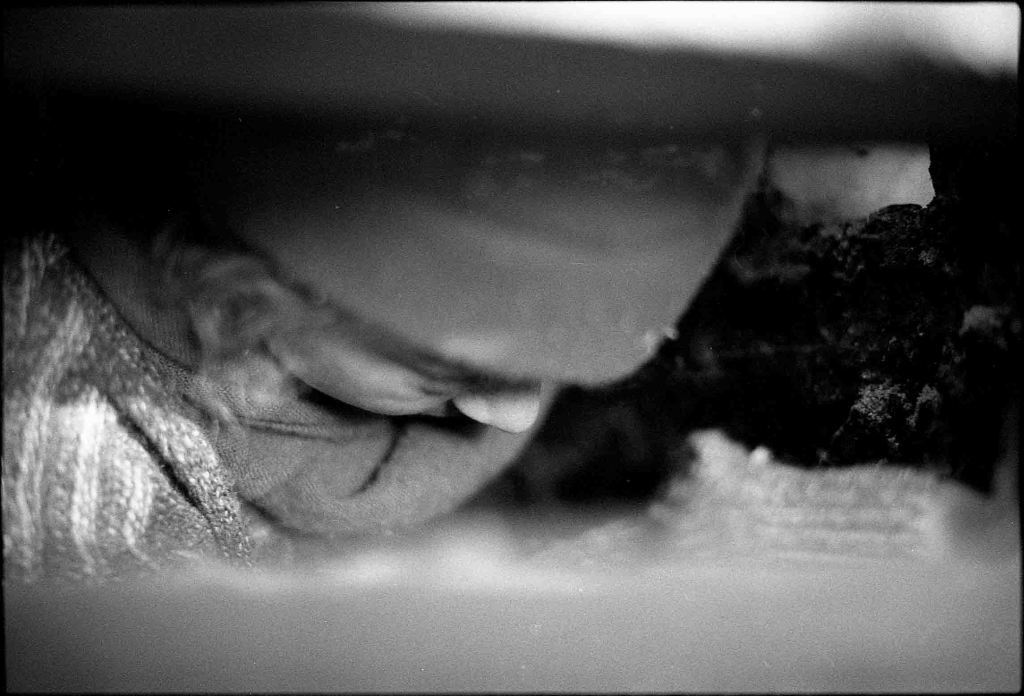












Avant la mise en route
Le 7 janvier, je les retrouve, une quinzaine de céramistes enfoncé·e·s dans la boue, les mains alourdies de torchis. L’effort est total, la fatigue omniprésente, accentuée par la pluie battante. Et pourtant, une énergie presque irréelle anime le groupe.
Le four, encore silencieux, attend son heure. Son isolation doit être renforcée, repoussant l’enfournement des premières pièces. Mais l’impatience se mêle à l’excitation. Car tous·tes ici sont animé·e·s par la même ambition : voir enfin la première tasse prendre place dans l’antre de ce géant de terre.
Avant que les premières braises ne viennent danser dans l’alandier, le chantier vibre d’une effervescence constante. La bétonnière tourne sans relâche, les pelles ramassent la terre humide à grandes brassées, les copeaux s’envolent en une pluie d’éclats projetés par la tronçonneuse. Chaque brique, chaque plaque est soigneusement engobée pour accueillir les céramiques, tandis que le bois s’empile avec une précision presque rituelle.
Rien ne peut être laissé au hasard, chaque tâche est essentielle au bon déroulement de la cuisson. Mais les jours s’étirent, les semaines s’enchaînent, et les reports successifs alourdissent les corps autant que les esprits. L’attente devient pesante, le temps se distord. Cette date, repoussée encore et encore, plane au-dessus du chantier comme une menace silencieuse, pesant sur la santé des travailleur·euses.
Le collectif n’est pas un choix, c’est une nécessité. L’ampleur de la tâche dépasse largement ce que pourrait accomplir une poignée de personnes. Et pourtant, cette obligation m’amène à m’interroger : comment éprouve-t-on le collectif, au fil des jours et des efforts partagés ? Pour certain·e·s, l’énergie du groupe est un moteur, une source inépuisable de motivation. Pour d’autres, c’est un rythme effréné qui impose de s’extraire, de respirer, de préserver ses forces.
Alors surgit une autre tension, plus intime : comment s’accorder du repos sans culpabiliser, quand d’autres s’épuisent sous la pluie diluvienne ? Mais ici et là, des voix soufflent des mots tendres aux oreilles épuisées : « Ne te fatigue pas trop. » — « Je prends le relai. » — « Ça te dit un café ? ». Sans règles établies, sans grands échanges sur la coopération, une attention mutuelle se tisse. Malgré la diversité des sensibilités, chacun·e veille sur l’autre, dans un équilibre fragile où la bienveillance est le torchis qui consolide le collectif.
Beaucoup utilisent un même mot pour décrire ce chantier : « Liberté. » La participation est volontaire, et chacun·e a accès aux différentes tâches. Lors de ma venue, peu de femmes sont présentes — ce qui n’a pas toujours été le cas tout au long des rénovations. Malgré cela, et malgré certaines remarques que j’estime venir d’un autre temps, celles qui sont là l’affirment : il est toujours possible de se faire une place.
À l’image de l’évolution du public dans les écoles de céramique, un clivage se dessine entre les générations. Les nouvelles professionnelles sont de plus en plus nombreuses, et les conditions de travail évoluent avec elles. Chez Tristan, rien n’est figé : collectivement, i·elles imaginent une répartition des tâches non genrée, investissent dans du matériel accessible à tous·tes — une tronçonneuse au poids modéré, un système de poulies facilitant l’ouverture des portes du four… Autant d’initiatives qui dessinent un espace plus inclusif, même si des ajustements restent à faire, des habitudes à questionner.












Atelier du soir, bonsoir
Dans la journée incompressible des potièr·e·s, une heure en fait deux, et vingt-quatre en paraissent quarante-huit. Lorsque la nuit tombe, l’atelier s’illumine.
Alors que les derniers rayons de soleil s’éclipsent à l’horizon, une deuxième journée commence. Patouiller la terre est une passion dévorante pour celles et ceux que je rencontre. Fatigue ou non, l’énergie semble inépuisable dès qu’il s’agit de modeler, tourner, gratter, émailler. Toutefois, ce qui nourrit ces nuits, bien plus que le travail manuel, ce sont les échanges.
La céramique est souvent une pratique solitaire, mais ces moments de retrouvailles sont précieux. Les discussions fusent, les rires résonnent, et les mots qui me parviennent sonnent comme une langue étrangère. Pourtant, jamais je n’ai ressenti autant de cohésion qu’au cœur de ces soirées, dans l’atelier de Tristan. Que certain·e·s façonnent, d’autres observent ou conseillent, toutes et tous convergent vers un même élan : créer des pièces qui les touchent profondément.

























L’enfournement
La dernière poignée de torchis est projetée contre le four. Les rénovations prennent fin. Après des semaines d’efforts, l’heure est venue de passer à l’étape tant attendue : l’enfournement.
Douzes mètres cubes vides s’ouvrent devant nous, prêts à accueillir les centaines de poteries apportées par près d’une quarantaine de céramistes. Mais le temps, encore une fois, joue contre nous. Chaque heure compte. La cuisson doit impérativement débuter au plus tôt, pour que le plus grand nombre puisse être là du début à la fin. Dans quatre jours, la première flamme devra s’élever.
J’imaginais que cette phase marquerait un apaisement, un ralentissement après l’intensité du chantier. Il n’en est rien. Un autre défi surgit. Le travail physique du torchis laisse place à une toute autre tension : celle d’une organisation millimétrée. Pièce après pièce, le vide se transforme en un agencement minutieux, pensé pour accueillir chaque création.
Et comme si cela ne suffisait pas, un autre danger menace : la pluie et le gel. Fragiles, les céramiques crues ne pardonneraient pas une exposition trop longue aux éléments. Cette ultime étape, plus qu’une simple transition, se dresse comme un mur infranchissable.
À l’image du fourragement des fourmis, l’acheminement des pièces s’organise spontanément. De l’atelier ou des camions jusqu’au four, les poteries passent de main en main. Dans le tunnel de briques réfractaires, d’autres s’affairent à les disposer consciencieusement. Ce geste, en apparence simple, cache une véritable science. Il faut anticiper la réaction du four à chaque emplacement, prendre en compte les particularités des pièces et les attentes de chacun·e.
Car ici, rien n’est laissé au hasard. Selon l’emplacement — troisième, deuxième ou première marche, première ou deuxième chambre, près ou loin des relais — la température varie, les flammes serpentent différemment. Chaque terre, chaque émail réagira à sa manière, modelé par l’alchimie du feu. L’exercice est d’autant plus délicat qu’il s’agit de la première cuisson depuis la rénovation. Même infimes, les modifications apportées au four transforment son comportement, rendant ses réactions plus difficile à anticiper.
Si, par moments, ce chantier évoque une colonie de vacances de céramistes, l’enfournement rappelle que la poterie est avant tout leur métier. Ce four ne renferme pas seulement des poteries, mais le fruit de mois de travail cumulés. Et malgré l’incertitude de cette première cuisson, l’espoir est que le plus grand nombre de pièces en ressorte à la hauteur des attentes, prêtes à être vendues.
Comme en photographie argentique, cette pratique artisanale est soumise à des variables que l’on ne maîtrise pas totalement. Pourtant, loin de se résigner à l’aléatoire, les céramistes analysent chaque détail, tentent de comprendre et d’anticiper ces éléments qui leur échappent. Les poteries que révélera l’ouverture du four ne seront pas le fruit du hasard, mais bien d’un savoir-faire, affiné au fil des expériences et des observations.
Au four et à mesure que le tunnel de briques se remplit, les tensions se cristallisent. Tout le monde ne pourra pas obtenir l’emplacement rêvé, et il faut négocier, faire des compromis. Chaque pièce doit trouver sa place, et la tâche pèse sur les épaules des joueur·euses de Tetris en terre crue. Il m’apparaît impossible de contenter tout le monde. Mais ici, la plupart des céramistes se connaissent, ont déjà cuit ensemble et recommenceront encore. Ce projet collectif fonctionne aussi parce qu’il s’inscrit dans une temporalité : une cuisson aujourd’hui, une autre demain. Rien n’est figé, les choix faits cette fois pourront être remis en question la prochaine.
Après quatre jours d’efforts, la dernière pièce est enfin posée sur la dernière plaque engobée disponible. Les portes du four, faites de briques et de torchis, sont scellées, enfermant des centaines de poteries dans l’Anagama. Ne restent visibles que les relais, ces ouvertures par lesquelles le bois alimentera le feu, et les regards, qui permettront de surveiller la montée en température. Puis, à 2 h du matin, la première allumette est craquée. Une flamme vacille, s’étire, s’empare du bois. Le feu est né, une nouvelle étape commence.
Les rayons du soleil filtrent à travers l’abri du four éclairant le deuxième quart, déjà à l’œuvre devant l’alandier, nourrissant les flammes. À l’image de la lumière qui inonde le Périgord, les visages s’illuminent de larges sourires, portés par une joie certaine.
Le rythme du projet collectif évolue encore. L’Anagama exige une attention continue pour dépasser les 1300°C. Quatre équipes se relaient : matin, après-midi, soirée et nuit.
Un brasier danse déjà dans la première chambre, mais le plus spectaculaire est encore à venir. Pourtant, je ne serai pas présent lorsque les flammes jailliront des relais et de la grande cheminée. Je n’assisterai pas à la magie des flammes blanches glissant sur les céramiques. Ce sont les récits des passionné·e·s qui sculpteront mon imaginaire, me transmettant l’essence de cette cuisson au four Anagama.









La fin d’une aventure, le défournement
Le 1er février, deux semaines après la fin de la cuisson, je retrouve Tristan, Maëlle et quelques compagnon·ne·s du chantier à Abjat-sur Bandiat. Un rendez-vous nous attend le lendemain : l’ouverture tant attendue du four. Il aura fallu près de quatorze jours pour qu’il refroidisse suffisamment et que l’on puisse en extraire chaque pièce.
Des sentiments d’excitation et d’appréhension se mêlent parmi les céramistes réuni·e·s. Depuis que les portes ont été scellées, personne n’a pu entrevoir la moindre poterie. L’incertitude plane : la surprise sera-t-elle éclatante ou amère ? Pourtant, en moi, une seule émotion domine : la joie de retrouver celles et ceux avec qui j’ai partagé le chantier. Peu importe les résultats, la journée à venir ne pourra être qu’extraordinaire.
Si le collectif est une nécessité, et non un choix, il continue de m’interroger. Aurais-je vécu cette immersion dans le monde de la céramique avec autant d’intensité autrement ?
Dans le four de Tristan, pour cette cuisson de janvier 2025, reposaient les pièces de trente-neuf céramistes. À cela s’ajoutent plus d’une dizaine de personnes venues prêter main-forte, parfois pour une journée, parfois pour plusieurs semaines.
Je tiens à remercier Tristan et Maëlle pour leur invitation, leur accueil et leur générosité. Merci aussi à toutes celles et ceux avec qui j’ai échangé, que ce soit quelques heures ou sur plusieurs jours. Ce reportage n’aurait pas eu la même profondeur sans leur désir de transmettre, leur attention. Certain·e·s ont même pris le temps de partager leur ressenti sur leur engagement et leur place dans ce collectif, au cours d’échanges émouvants menés lors d’entretiens individuels. Grâce à elles et eux, j’ai pu observer, comprendre et, aujourd’hui, raconter.
Merci Amélie, Anne-Lise, Arnaud, Boris, Boris, Céline, Chloé, Cybèle, Elina, Frédérique, Gaëlle, Guillaume, Jean, Joseph, Juliette, Lucile, Manon, Maryse, Mathieu, Mathieu, Melany, Quentin, Richemond, Thomas.
